L’intersexuation et les juges français
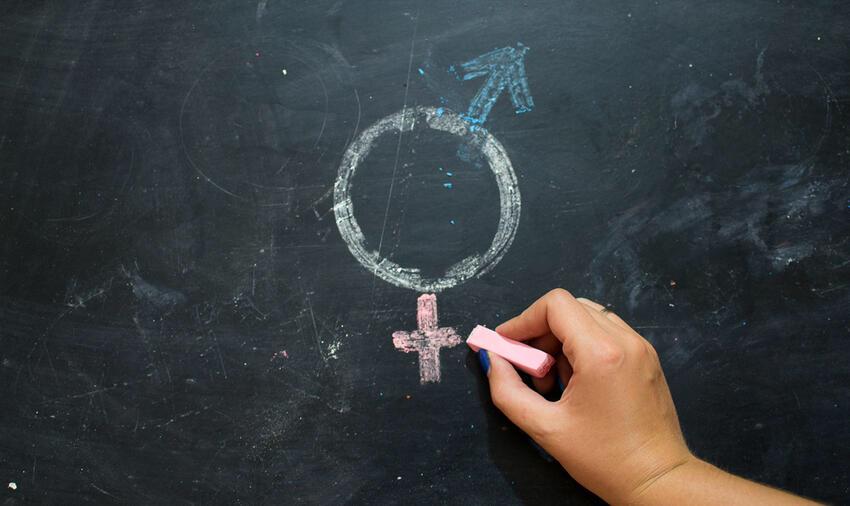
Avant-propos
Dans notre société, tout individu auquel le Droit reconnaît la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à avoir des droits et des obligations, se trouve automatiquement identifié par une pluralité d’attributs que sont notamment le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile ou encore le sexe. Ces éléments constituent l’état des personnes, qui est par principe, immuable, imprescriptible et indisponible. En effet, ces éléments constituant notre état civil nous suivent de notre naissance à notre mort.
Concernant le sexe, le droit français est traversé par un principe de binarité: il est soit féminin, soit masculin. Cette appréciation s’effectue dès la naissance et est retranscrite sur les registres de l’état civil.
Problématique
C’est alors qu’un problème se pose: nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions types homme/femme, les personnes intersexuées se trouvent contraintes «d’entrer» dans l’une ou l’autre catégorie. L’état civil se révèle être un véritable obstacle à la reconnaissance de leur état biologique.
Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date 04 mai 2017 (n°16-17189) est particulièrement évocatrice de la difficulté de reconnaissance juridique de l’intersexuation.
Les faits de l’arrêt sont les suivants :
Dans les années 1950, un enfant naît avec une ambiguïté sexuelle mais est déclaré à l’état civil comme étant de sexe masculin. Biologiquement, son corps ne répond pourtant pas à la binarité sexuelle légalement établie par le législateur français.
Âgé d’une trentaine d’années, il souffre d’une ostéoporose (fragilité osseuse) et est contraint de subir un traitement hormonal à base de testostérone, lui donnant une apparence masculine.
En 2015, soucieux de faire reconnaître son intersexuation, il forme une demande de rectification de son acte de naissance afin que soit substitué à la mention « sexe masculin » la mention « sexe neutre » ou « intersexe ».
Le tribunal de grande instance de Tours fait droit à sa demande. Cependant, la Cour d’appel d’Orléans invalide cette décision. Pour cette dernière, la demande de l’intéressé ne pouvait en effet être accueillie en raison de deux motifs principaux.
D’une part, celle-ci apparaissait « en contradiction avec son apparence physique et son comportement social ».
D’autre part, en l’absence « de dispositions législatives et réglementaires permettant de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté sexuelle, admettre la requête de l’intéressé reviendrait à reconnaître, sous couvert d’une simple rectification d’état civil, l’existence d’une autre catégorie sexuelle, allant au-delà du pouvoir d’interprétation de la norme du juge judiciaire et dont la création relève de la seule appréciation du législateur ».
En réaction, l’intéressé se pourvoi en cassation en reprochant aux juges d’appel de s’être fondés sur son apparence physique pour rendre leur décision, alors même que celle-ci ne relevait pas d’un choix personnel mais du traitement médical de son ostéoporose, et que l’identité sexuée résulte selon lui davantage «du sexe psychologique, soit de la perception qu’a l’individu de son propre sexe».
De plus, il met en avant que le juge doit veiller au respect des droits et libertés fondamentaux de chacun prévus par les conventions internationales auxquelles la France est partie. De ce fait, la Cour d’appel aurait violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour de cassation admet que la loi française constitue sur ce point une ingérence dans le droit du requérant de faire établir les détails de son identité.
Cependant, les juges justifient cette ingérence, qui poursuit, selon eux, «un but légitime, en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur » et « que la reconnaissance par le juge d’un «sexe neutre» aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ».
La Cour suprême ne s’arrête pas là et reprend l’argument de la Cour d’appel visant le fait que le demandeur avait bien «l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance». En effet, le requérant était marié à une femme, père adoptif d’un enfant, doté d’une voix grave et d’une pilosité masculine, tout portait, selon les juges à faire de lui un homme, suivant une «normalité socialement admise».
La Cour de cassation s’arroge ainsi la faculté d’édicter les contours de la notion de normalité sociale selon des considérations bancales si ce n’est totalement déplacées. Notre orientation sexuelle déterminerait-elle notre identité sexuelle biologique?
Bien que l’argument selon lequel la reconnaissance d’un troisième sexe affecterait l’organisation sociale et juridique peut trouver une légitimité à nos yeux, la décision de la haute juridiction apparaît tout de même contestable. En effet, les juges s’approprient en quelque sorte le monopole de la définition du sexe masculin tout en omettant totalement le caractère physiologique et le sentiment d’appartenance psychologique non-binaires de la personne.
Il est important de noter qu’un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme a été introduit le 31 octobre 2017 contre cet arrêt de la Cour de cassation. La décision de la CEDH n’est, à ce jour, pas encore connue.
Tour d’horizon
Un rapport de la Cour de cassation à propos de l’arrêt précédemment étudié offre quelques perspectives comparatives. L’Australie, et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande et le Népal, disposent d’une classification à trois termes. Les Australiens prévoient les sexes « masculin », «féminin» ou «X» pour les personnes au sexe indéterminé, intersexué ou non-spécifié.
Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe avait émis la recommandation aux Etats-membres de faciliter la reconnaissance des personnes intersexuées (23/06/2015 – http://rm.coe.int/09000016806da66e ).
En la matière, ce sont nos voisins Allemands qui ont ouvert la marche. Dans un premier temps, il avait été admis par une loi du 07 mai 2013, entrée en vigueur le 1er novembre de la même année, que le sexe de l’enfant né intersexué ne soit pas mentionné immédiatement dans les actes de l’Etat civil : le droit allemand n’avait donc pas reconnu un troisième sexe positivement, mais il admettait une « mention négative » de cet état intersexué dans les actes de l’état civil.
Dans une décision rendue le 10 octobre 2017, le Tribunal constitutionnel Allemand a considéré que le refus d’inscription d’une mention positive (le fait d’ajouter une mention d’identification sexuelle) constitue une atteinte injustifiée au droit de la personnalité de la personne, droit protégé par la loi fondamentale Allemande de 1949 (équivalent de notre Constitution).
Pour le Tribunal constitutionnel, l’inscription positive d’un genre neutre n’enlèverait aucun droit aux tiers, ne causerait que de faibles contraintes bureaucratiques et n’entraînerait aucun problème nouveau par rapport à ceux induits par la possibilité déjà existante de ne pas inscrire la mention du sexe à l’état civil. En ce sens, le Tribunal constitutionnel appelle donc le législateur Allemand à modifier le droit afin d’inclure et de reconnaître l’intersexuation.
Cette décision du Tribunal constitutionnel Allemand serait sans nul doute transposable en France. En effet, quoi qu’en dise la Cour de cassation, le droit Français actuel permet déjà de ne pas inscrire de mention du sexe de l’enfant à l’état civil, avec l’accord du procureur de la République, au visa d’une circulaire (faible valeur juridique, la circulaire se trouve en bas de la hiérarchie des normes) du 28 octobre 2011 (paragraphe 55).
Bien que la décision de la Cour suprême précédemment étudiée réfute ceci et soit maladroitement fondée, elle a tout de même le mérite de lancer un appel au législateur dont l’intervention tarde à arriver. En effet, le dépassement de la binarité sexuelle semble inévitable et passera nécessairement par une initiative parlementaire. Audacieux celui qui s’aventurerait à parier sur la date de son avènement.
Clinicien de la Clinique Juridique de l’AJSPN et étudiant en master 2 contentieux des droits et libertés fondamentaux à l’Université Sorbonne Paris Nord.

